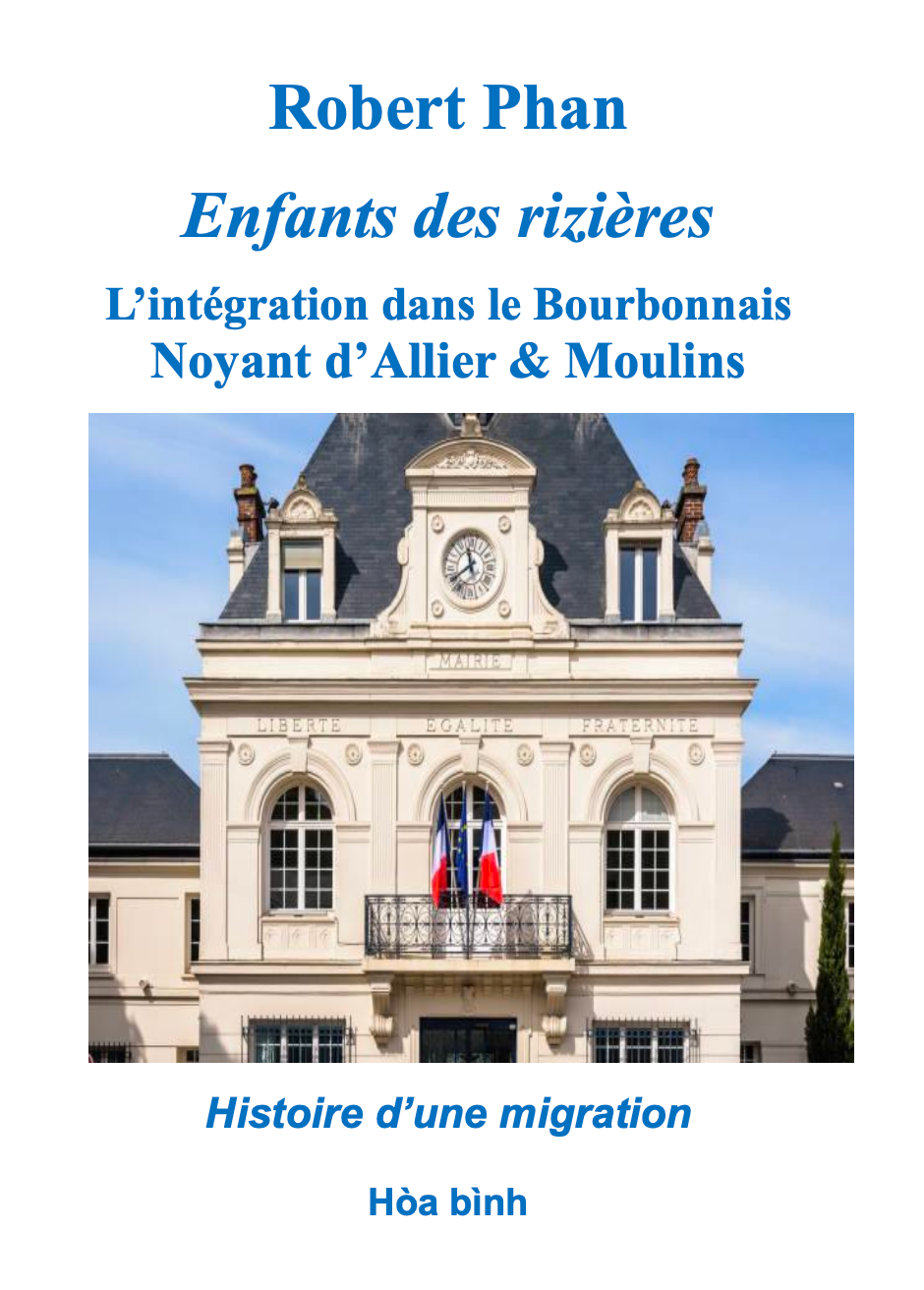Enfants des rizières
L’intégration dans le Bourbonnais
Extraits du livre
11 – De la bassine aux douches publiques
[« Donnant directement sur la porte d’entrée, la pièce de vie de 15m2 servait à la fois de cuisine, avec un évier et un unique robinet d’eau froide, un grand poêle à charbon ; de salle à manger pour notre famille de neuf personnes ; de bureau pour les devoirs scolaires des enfants ; de salle de prière car sur le buffet trônait une statuette de bouddha au milieu de l’autel des ancêtres ; de salon pour accueillir les visiteurs ou les invités ; de séchoir pour le linge ; de salle de bain, dans laquelle les parents se lavaient quand les enfants étaient à l’école.
Et il fallut prévoir un roulement pour différencier les jours de bain des filles et des garçons dans la grande bassine qui servait aussi à faire la lessive. Les filles se baigneraient les mercredis pour les petites, les jeudis après-midi pour les grandes, et concernant les garçons, les samedis après-midi, jours de congés scolaires.
Après quelques mois, le rituel était bien rôdé.
Le bain des enfants, c’était un peu folklorique : quand les filles se baignaient, le rideau de la porte-fenêtre donnant accès à l’étage était hermétiquement tiré ; les garçons confinés dans leur chambre ou jouant dehors quand la météo le permettait, le temps de la toilette des demoiselles.
Et l’inverse se produisait quand les garçons se décrassaient.
Une fois par semaine, c’était la grande toilette ; les autres jours, chacun-e se débarbouillait à sa guise avec un gant et du savon. Je prenais donc deux douches par semaine, une le mercredi, comme interne, au lycée Banville et une autre à la maison, le samedi après-midi.
Un voisin de Varennes-sur-Allier, (où je réside actuellement en 2024), Jacky, Bourbonnais de toujours, m’informa que dans les années 1960, dans les maisons de la campagne bourbonnaise, un grand nombre de familles se baignaient, dans la même bassine qui servait à faire le linge, comme les habitants des corons de Noyant.
Il relativisa même mes explications sur notre sort en rajoutant qu’il n’avait connu sa première douche qu’à l’âge de vingt ans, en 1959, à Varennes-sur-Allier, où les premiers bains-douches venaient d’être construits avec deux baignoires et huit douches.
A Noyant, des douches publiques, une dizaine de cabines, avaient été mises en service à partir de 1965, dans un village peuplé, à l’époque, d’environ 1600 habitants, dont la moitié logeait dans les corons.
A l’ouverture de ces douches municipales, situées au croisement du premier coron et de la rue de la mine, nous étions toutes et tous tellement heureux de cette amélioration du confort, de ce bond en avant, de ce modernisme…aujourd’hui, relégué à un passé indigent !
Ces douches publiques eurent un tel succès parmi les habitants des corons, qu’un an plus tard, après la fermeture officielle du Centre d’accueil des rapatriés d’Indochine et la vente des corons à leurs résidents ; petit à petit, chez les nouveaux propriétaires, on vit fleurir dans tous les corons des échafaudages pour la rénovation des habitats, tant de la toiture et de la façade que de l’intérieur de la maison, dans laquelle la construction des sanitaires et de la douche avec l’eau chaude était devenue prioritaire.
En réalité, même du temps des bains pris dans la grande bassine, la lessiveuse, nous étions déjà des privilégiés, sans le savoir ; nous étions mieux lotis que les seigneurs du château des Bourbons. C’est en tout cas ce qu’explique, lors de la visite, la guide du Château de Bourbon l’Archambault.
Quand le roi prenait son bain, les aristocrates, les seigneurs, les courtisans de sa suite, se faisaient un honneur de se baigner dans ces mêmes eaux, après le monarque. Ils passaient chacun leur tour en fonction du rang hiérarchique. Le énième nobliau de la suite royale devait probablement tremper dans la même eau glauque et nauséabonde que celle des nombreuses mares du Bourbonnais. Le gentilhomme sortait-il du bain vraiment plus propre qu’avant d’y être entré ?
Des historiens ne racontent-ils pas que le Château de Versailles était un endroit sale, où la famille royale comme les courtisans et visiteurs faisaient leurs besoins n'importe où, dans tous les recoins ? »] …
30 – La nostalgie des parents à Noyant
[« Comment notre maman d’origine vietnamienne, âgée de 43 ans, analphabète, devant gérer une famille de sept enfants, s’était-elle organisée, adaptée dans les corons de Noyant, entre 1962 et 1967 ? Souffrait-elle de la nostalgie du pays natal ?
Le quotidien de notre mère n’était pas particulièrement singulier ; il correspondait peu ou prou à celui de presque toutes les mères et tatas des corons, à la même époque.
C’était une vie de transition, entre la conservation de certaines traditions vietnamiennes, lao, et l’intégration, l’adaptation progressive aux us et coutumes de la société française.
Durant les premières années, maman était habillée selon la mode vietnamienne. Les jours ordinaires, elle était vêtue d’une chemisette de couleur claire et d’un pantalon sombre en coton ou en satin ; quand elle sortait, la plupart du temps, elle avait son chapeau conique (nón lá) sur la tête.
Les jours de fête, par exemple pour le Nouvel an vietnamien, le Têt, qui a lieu entre le 15 janvier et le 15 février, maman mettait une robe longue traditionnelle de son pays natal (le áo dài – prononcer : áo zài). Et pour la cérémonie du Nouvel an lao, le Boun Pimay, autour du 15 avril, anniversaire de « l’éveil de Bouddha », maman revêtait une jupe traditionnelle lao (le ສິ້ນ - le sin).
C’était ainsi habillée, comme la plupart des mamans rapatriées d’Indochine, avec son chapeau conique sur la tête, que maman alla, tous les vendredis au marché de Moulins, acheter des fruits, des légumes, des poissons frais et surtout des volailles vivantes.
Toutes les tatas revenaient ensemble du marché, et les Moulinois, chaque semaine, avaient la chance d’assister, de la place d’Allier à la gare, à un défilé folklorique de femmes asiatiques transportant par grappes des volailles gesticulant dans tous les sens : des poules, des poulets, caquetant, des canards, nasillant et même des oies, gloussant, les plus remuantes. Un spectacle inoubliable !
Et dans la Micheline, de retour vers Noyant, le même folklore se produisit ; les mamans occupaient beaucoup de places avec leurs victuailles. Dans le train, il y avait aussi le son monté à bloc ; elles parlaient fort en vietnamien nos mamans et nos tatas, tout en s’éventant avec leurs chapeaux coniques !
Les jours de vacances scolaires, où j’accompagnais maman au marché, dans le train, je me faisais tout petit ; notre groupe de « Chinois » n’étant pas des plus discrets, l’ambiance n’était pas triste, les tatas riaient souvent aux éclats.
Mon seul souci, sur le trajet de Moulins à Noyant, était de me rendre le plus invisible possible. J’avais 13-14 ans.
Il y avait les volailles qui battaient de l’aile en permanence mais aussi de nombreux légumes qui débordaient des sacs et des paniers.
Dans la cuisine d’Asie du sud-est, on mange des légumes, des salades, des concombres, du soja, des poivrons, des aubergines…en abondance. Sans compter le besoin en aromates et en épices dans tous les plats : coriandre, citronnelle, aneth, menthe, thym, persil plat…
Maman qui était cuisinière de métier, elle était restauratrice au marché de Cholon, aimait alterner les plats vietnamiens, lao, et les mets européens, blanquette de veau, bœuf bourguignon, steak frites, pizza, paëlla…si bien qu’on préférait manger à la maison qu’au restaurant.
Dans les corons, un marchand ambulant venant de Bourges proposait des produits asiatiques tous les mardis. Et qui ne se souvient pas de Madame de Chaume, circulant sur son tracteur, régulièrement, dans les allées des corons, avec ses fruits et légumes, ses produits frais de la ferme, des œufs, des fromages ?
Quand je repense à Madame de Chaume, je me remémore le lait frais que nous allions chercher à la ferme, derrière la boulangerie. En réalité, il n’était pas frais le lait, il était tiède, crémeux, onctueux ; j’en garde encore en bouche la douce saveur tant désirée lorsque je tenais le bidon de lait en fer blanc à la main, sur le chemin de la ferme.
Ce brassage des cultures apportait un certain éclat des goûts et des couleurs qui me ravivait chaque fois que ces commerçants klaxonnaient pour signaler leur présence. J’accourais pour découvrir les marchandises proposées ; rien que de les voir, certaines me faisaient saliver !
Dans les corons, il y avait une économie parallèle, certaines familles complétaient les revenus par la vente de gâteaux à la pâte de soja (bánh cám), de plats de rouleaux de pâte de riz et de crêpes au porc et aux crevettes (bánh cuốn, bánh bèo), ou de piments, comme l’avait fait mon beau-frère Pierrot, le mari de ma grande sœur Khampheth.
Il y avait aussi des caisses de solidarité, les tontines (hui, en sino-vietnamien) qui tournaient pour aider chaque mois, une famille dans le besoin, à régler une dépense.
Il faut savoir que les affinités, les amitiés, entre les tatas ne se faisaient pas par hasard ; les mamans vietnamiennes, par exemple, se regroupaient souvent en fonction de la région d’origine : le Tonkin (le nord, région de Hanoi, le Bắc Kỳ), l’Annam (le centre, région de Huê’), la Cochinchine (le sud, région de Saïgon, Nam Kỳ).
Et au Vietnam, il existe pratiquement trois langages, trois accents différents : l’accent du nord : tiếng bắc ; l’accent du centre : tiếng huê' ; l’accent du sud : tiếng miền nam.
Notre maman, originaire du centre-Vietnam, avait pour principales amies des tatas parlant avec le vocabulaire et l’accent de Huê’ (nói tiếng huê') ; ce qui était le cas de Madame Dubernet, mais aussi d’autres tatas : Mmes Truong, Lebel, Hoareau, Wahrheit…
Dans les corons, les femmes parlaient majoritairement le vietnamien entre elles ; un français rudimentaire avec les enfants mais parfois, c’était les enfants qui pratiquaient un vietnamien rudimentaire avec leurs mamans.
Quant aux hommes, ils parlaient principalement le français entre eux. Certains, peu nombreux, connaissaient la langue de leurs épouses, le vietnamien, le lao, le cambodgien, ou le tamoul. Monsieur Beaupère, par exemple, le papa d’Hubert, notre voisin et beau-frère, parlait souvent en lao avec son épouse originaire de Savannakhet…
… Question pratique religieuse, maman, qui était bouddhiste, avait un autel des ancêtres trônant à côté d’une statuette de Bouddha, sur le buffet de la pièce de vie (qui servait à la fois de salle à manger, de salle de bains, de cuisine, de séchoir, de salle d’études, de salon de réception des invités, et donc de salle de prière…).
En réalité, de nombreuses tatas qui s’étaient converties au catholicisme avaient aussi gardé un autel des ancêtres, parfois même une statuette de Bouddha, près d’un crucifix et de la Vierge Marie.
C’était une des particularités œcuméniques visibles dans les corons de Noyant dans les années 1960-1970.
Cet œcuménisme perdure jusqu’à nos jours ; bon nombre de Noyantais des corons participent à la fois aux cérémonies religieuses à la pagode et à la messe à l’église. Notamment au moment des obsèques, que ce soit après l’incinération ou avant l’enterrement.
Fréquenter à la fois l’église et la pagode devient commun à Noyant, pour les habitants des corons.
Les bouddhistes participent volontiers aux cérémonies organisées par l’église ; l’intégration se faisant dans la tolérance et le respect des coutumes du pays d’accueil.
Les catholiques, originaires de l’Indochine, vont à la pagode car bon nombre d’entre eux conservent encore une culture, des racines bouddhistes.
Toutes et tous participent à un vivre-ensemble noyantais, empreint de tolérance et de sororité, de fraternité. »]…